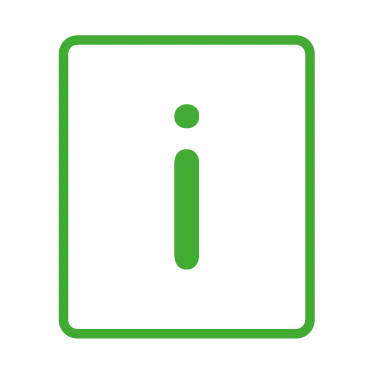47 millions d’euros. C’est le montant record versé en 2022 par les fédérations de chasseurs pour compenser les dégâts de sangliers sur les cultures françaises. Derrière ce chiffre vertigineux, un système singulier, des tensions à vif, et une question qui dérange : qui doit vraiment payer l’addition d’une faune qui déborde ?
Sangliers en France : une pression grandissante sur les territoires ruraux
La prolifération des sangliers bouleverse les campagnes françaises. Classé parmi le grand gibier, au même titre que le chevreuil ou le cerf, le sanglier se distingue par l’ampleur de ses dégâts agricoles. Les chiffres de l’ONCFS sont sans appel : avec des hivers plus cléments et des friches qui gagnent du terrain, le nombre de bêtes explose, compliquant chaque année un peu plus la donne.
Les dégâts causés par les sangliers, champs labourés, récoltes dévastées, clôtures mises à mal, attisent les conflits entre agriculteurs et chasseurs. La tâche de compenser ces pertes revient aux fédérations départementales de chasseurs. Mais si la gestion de la chasse montre ses failles, l’État reprend la main, un scénario que beaucoup redoutent au niveau local.
Les collectivités ne sont pas en reste : un manque de signalisation sur la route ou la fuite d’un animal d’un parc public peut engager leur responsabilité si un accident survient. Au final, la gestion du sanglier devient un sujet de crispation. Chaque acteur est sommé d’assumer sa part, mais l’équilibre reste fragile.
Quels sont les impacts économiques des dégâts causés par les sangliers ?
Les dégâts agricoles des sangliers se chiffrent au fil des hectares retournés et des cultures détruites. Année après année, la facture grimpe : près de 80 millions d’euros à l’échelle nationale, dont 85 % directement imputables à ces animaux. Le secteur agricole en subit les conséquences, avec des récoltes amputées et des aménagements à refaire.
Quelques exemples concrets illustrent l’impact de ces dégâts :
- Des cultures entières de maïs, de blé ou de tournesol anéanties en une seule nuit
- Des clôtures et des installations agricoles détruites, forçant des réparations coûteuses
- Des pelouses et terrains de sport retournés, nécessitant d’importantes remises en état
Au-delà des exploitations, le phénomène touche aussi les routes. Les accidents impliquant des sangliers sont fréquents sur les axes ruraux, générant des frais parfois lourds, dont la prise en charge dépend des contrats d’assurance et, parfois, de l’implication des collectivités en cas de défaut de signalisation.
Pour mesurer les pertes, un estimateur intervient, mandaté pour constater et évaluer les dommages. Ce passage obligé conditionne toute demande d’indemnisation et influence les échanges entre agriculteurs, chasseurs et pouvoirs publics. Avec des populations de sangliers toujours plus denses, le coût du dispositif pèse chaque année davantage.
Chasseurs, agriculteurs, État : qui prend en charge les frais et selon quelles règles ?
Le système français d’indemnisation des dégâts de sangliers est unique sur le continent. La fédération départementale des chasseurs prend en charge la quasi-intégralité des indemnisations dues aux agriculteurs. Ce financement s’appuie sur la solidarité du monde de la chasse : cotisations des adhérents, redevances du permis, contribution additionnelle obligatoire. Les montants indemnisés suivent un barème préfectoral, ajusté selon la culture touchée et la localisation.
Pour prétendre à l’indemnisation, l’agriculteur doit signaler les dégâts dans des délais précis : cinq jours après la découverte, six mois s’il y a procédure judiciaire. Un estimateur indépendant, désigné par la fédération des chasseurs, évalue alors les pertes. Si un désaccord surgit, la commission départementale d’indemnisation intervient. Au-delà de 3 000 €, le litige peut monter devant la commission nationale d’indemnisation.
L’État n’intervient qu’en cas de défaillance notable du système, ou si la fédération perd la gestion de la chasse. Les particuliers, sauf clause contractuelle spécifique, ne bénéficient d’aucune indemnisation. Quant à la franchise, elle reste le plus souvent à la charge de l’exploitant, sauf dérogation selon certaines cultures ou régions.
Les syndicats agricoles, notamment la FNSEA et la Coordination rurale, épaulent les exploitants dans leurs démarches. Des accords passés entre l’État, la Fédération nationale des chasseurs et les organisations agricoles cadrent le dispositif. Mais les discussions restent animées, alors que la pression du grand gibier ne faiblit pas dans les campagnes.
Vers de nouvelles solutions pour gérer les populations et indemniser les victimes
Le monde agricole réclame des actes face à l’ampleur des dégâts de sangliers. En mars 2023, un accord national a été signé entre la Fédération nationale des chasseurs, l’État, la FNSEA, la Coordination rurale et les chambres d’agriculture. Objectif affiché : réduire de 20 à 30 % les dommages liés aux sangliers en trois ans. La méthode ? Miser sur la coopération et placer la régulation au centre du dispositif.
L’État a annoncé une enveloppe de 80 millions d’euros pour soutenir ce plan. La répartition est la suivante :
- 20 millions consacrés à l’indemnisation directe des exploitants touchés
- 60 millions dédiés à la régulation de la faune et à l’intensification des prélèvements
La régulation passe non seulement par l’augmentation des prélèvements, mais aussi par la mobilisation des acteurs locaux. Les fédérations départementales adaptent les plans de chasse, investissent dans la logistique et renforcent la formation des chasseurs.
Les syndicats agricoles participent activement aux discussions, exigeant un suivi rigoureux et une adaptation constante des outils. La régulation agro-sylvo-cynégétique s’impose peu à peu comme une piste sérieuse pour rétablir l’équilibre entre agriculture, biodiversité et chasse. Les collectivités s’engagent aussi, notamment pour la signalisation routière et la prévention des accidents impliquant des animaux sauvages.
Les attentes du terrain restent élevées : clarté sur l’indemnisation, efficacité dans la gestion et capacité d’anticipation face à l’évolution des populations. Il s’agit d’éviter que chaque dégât ne finisse devant les tribunaux et de privilégier le dialogue pour avancer.
La question demeure : jusqu’où ce fragile équilibre tiendra-t-il, face à des sangliers plus nombreux et des campagnes à bout de souffle ? L’histoire n’a pas fini d’écrire son prochain chapitre.